Plusieurs se demandent pourquoi les luttes écologistes allochtones se lient régulièrement avec celles des camarades Autochtones contre le colonialisme. On peut notamment penser à Shut Down Canada en 2019-2020 contre le pipeline CGL en territoire Wet’suwet’en, au mouvement #NODAPL contre le Dakota Access Pipeline, aux manifestations contre la ligne 3 du pipeline Enbridge au Minnesota, et à la lutte actuelle contre le projet de pipeline PRGT en territoire Gitxsan. Il est en effet intéressant de réfléchir à la pertinence, à la portée et aux objectifs de nos luttes. Non pas pour renoncer, mais parce que mieux comprendre pourquoi on milite permet de garder la motivation et de répondre aux réfractaires. Voici donc quatre arguments pour tenter de faire face à vos mononc’ pendant les soupers de famille:) Amusez-vous!
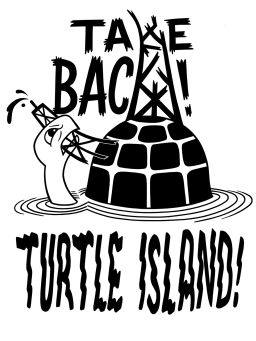
Les allochtones profitent du système colonial
En tant qu’allochtones, on profite du système actuel, qui s’est enrichi historiquement et continue de s’enrichir par la colonisation et l’exploitation des populations et des territoires Autochtones. Cela explique entre autres les disparités économiques qui subsistent encore de nos jours entre les communautés Autochtones et allochtones. On a donc la responsabilité d’agir face à ce système d’oppression, dont on tire des privilèges, qu’on le veuille ou non. En effet, les populations opprimées et marginalisées ne devraient pas avoir à porter seules le fardeau de leur libération collective. Comme l’affirment Eve Tuck et Wayne Yang dans leur ouvrage Decolonization is not a metaphor, reconnaître l’oppression coloniale n’est pas suffisant : pour éviter de tomber dans le piège de « l’innocence blanche », il importe de combattre activement le colonialisme en plus de s’éduquer et de s’informer sur cet enjeu. En tant que priviligié·e·s du système colonial, les colon·ne·s de l’Île de la Tortue devraient, à la hauteur de leurs moyens, contribuer à la lutte anti-coloniale. Leurs privilèges leur donnant accès à des ressources plus grandes que les communautés opprimées par l’État colonial, ces ressources supplémentaires pourraient être redirigées vers les luttes de résistance anticoloniale.
De plus, la libération collective dépend de la destruction de tous les systèmes d’oppression. En d‘autres mots, les Blanc·he·s ne seront pas libres tant que leurs camarades Autochtones seront réprimé·e·s. De la même manière, les femmes blanches ne seront pas libérées du joug du patriarcat tant et aussi longtemps que la mysoginoire existe. La destruction du capitalisme n’entrainera pas magiquement le colonialisme sur son passage, et inversement. En bref, la libération de toustes dépend de la libération de chacun·e.
L’État est un ennemi commun
Non seulement Autochtones et allochtones n’obtiendront pas leur libération sans l’autre, mais iels militent contre un ennemi commun. En effet, l’État colonial canadien n’est pas seulement problématique pour les Autochtones, il l’est aussi pour les allochtones.
Quand on parle d’État-Nation, il s’agit d’une structure coloniale basée sur un système économique, le capitalisme, marqué par un accroissement de l’écart de la richesse entre les plus riches et les plus pauvres. Bien que certain·e·s croient qu’un État fort serait la seule chose pouvant nous protéger des grandes entreprises, on a pu voir, par exemple dans le dossier Northvolt, comment la classe politique est en fait à genoux devant le Grand capital. C’est la logique même de l’État capitaliste : pour que le système semble fonctionner, il doit maintenir une croissance économique. Pour ce faire, l’État soutient cette croissance grâce à la volonté d‘investissement des milliardaires de ce monde. Or, le capital n’investit que là où c’est possible de faire du profit, là où la culture syndicale est amoindrie, là où les minorités sont opprimées et prêtes à tout pour avoir un emploi, là où l’injustice est loi.
Les communautés Autochtones, en retour, ont subi les violences de l’État et du capital de manière bien différente, tel qu’il a été montré dans les nombreux articles précédents. La soif incessante de profit de l’État et du capital détruit les vies des allochtones bien différemment de celles des Autochtones, mais leurs résistances ont la même source. Nos mouvements ont tout à gagner à amplifier leurs voix, car nous avons le même ennemi. Les reprises des territoires (Land Back) agissent en fait de manière à retirer des terres du contrôle de l’État canadien. C’est pourquoi les mobilisations anticoloniales offrent des opportunités incroyables d’alliance contre l’État et le Grand capital.
Ainsi, l’État opprime les Autochtones, mais aussi les allochtones : c’est aussi l’ennemi des militant·e·s anti-colonialistes, anti-autoritaires, anti-oppressions et anti-capitalistes. Une alliance et une collaboration entre militant·e·s Autochtones et allochtones contre leur ennemi commun, l’État colonial capitaliste oppressif, permettraient d’augmenter nos capacités de lutte collectives.
Toutefois, les complices allochtones doivent faire particulièrement attention aux relations interpersonnelles et collectives dans ce type d’alliances. Trois constats s’imposent en ce qui concerne ces luttes anticoloniales : premièrement, reconnaître que les communautés en lutte doivent être celles qui déterminent les paramètres et les formes d’action. Cela ne limite en rien les militant·e·s allochtones : iels peuvent toujours attaquer les entreprises minières et pétrolières pour ce qu’elles sont, de même que s’en prendre à Hydro-Québec et à l’État québécois. Il importe alors de ne pas prétendre agir en solidarité anticoloniale si ce genre de mobilisation n’a pas été sollicitée.
Le deuxième constat est la continuation du premier : en tant qu’allochtones, il faut se questionner sur comment cette présence influence et transforme les luttes, afin d’éviter que cette influence ne reproduise des dynamiques coloniales. Pour le dire autrement, les allochtones ne doivent pas s’imposer en sauveur·euse·s : les communautés Autochtones n’ont pas besoin d’être sauvées. Un mouvement anticolonial approprié, coopté et mené par des colon·ne·s n’est qu’une reproduction du colonialisme au sein même de la résistance.
Troisièmement, il importe de créer et de maintenir des relations au moins réciproques entre militant·e·s allochtones et Autochtones, en veillant à donner plus que l’on ne prend dans ces relations.
Les militant·e·s Autochtones ont une riche expérience de résistance anticoloniale
Suite à l’arrivée des Européen·ne·s, les Autochtones ont été systématiquement ciblé·e·s par l’extractivisme colonial : iels peuvent donc clairement percevoir la profonde injustice et la non-durabilité du capitalisme colonial, et son lien avec la crise climatique. Étant donné leur historique de lutte contre l’État colonial, les Autochtones ont en outre une expérience et des pratiques de lutte non négligeables dans la résistance au système : il serait pertinent de s’en inspirer, d’y collaborer et/ou de les soutenir. En créant de tels ponts, on renforce les liens entre les communautés militantes Autochtones et allochtones, en apprenant les tactiques et les stratégies de chacun·e pour enrichir et co-construire nos connaissances, tout en facilitant les alliances futures qui augmenteront nos capacités de lutte collectives.
Les communautés Autochtones sont parmi les plus mobilisées qui existent sur le territoire du soi-disant Canada. Elles organisent déjà, notamment, des blocages, des campagnes d’information et construisent des alliances. On n’a rien à gagner collectivement à ce que des ONG (Greenpeace, David Suzuki, etc.), qui gambadent main dans la main avec les multinationales et les politicien·ne·s, s’approprient ces luttes. Il est préférable que les personnes développent leurs capacités à résister aux grandes entreprises et à l’autorité coloniale, en apprenant des pratiques d’organisation des communautés.
Le but ici ne serait pas de copier ou de suivre telles quelles les orientations des luttes Autochtones, mais d’être à l’écoute et de prendre connaissance de leurs choix politiques afin de bénéficier de leurs connaissances et expériences. En effet, se soumettre sans réflexion critique aux décisions de personnes Autochtones simplement parce qu’elles sont Autochtones est une forme d’essentialisation qui reproduit des dynamiques coloniales. Ce comportement réduirait les militant·e·s Autochtones à leur identité, au lieu de les considérer comme des personnes à part entière, ayant une agentivité et une réflexivité critique. S’inspirer des militant·e·s Autochtones uniquement parce qu’iels sont Autochtones insinuerait qu’en dehors de leur appartenance ethnique, iels n’auraient rien à apporter au mouvement, ce qui est excessivement paternaliste et colonial. Au contraire, on bénéficierait de prendre en compte le point de vue des militant·e·s Autochtones étant donné les savoirs et compétences que leurs communautés ont acquis grâce à leur vécu particulier.
On ne peut détruire le système capitaliste colonial avec les mêmes outils qui l’ont créé
Enfin, il y a un grand contraste entre les actions des États-Nations colonisateurs européens sur l’Île de la Tortue, qui en seulement quelques centaines d’années nous ont amené·e·s au bord de l’effondrement écologique et climatique, et les communautés Autochtones d’ici et d’ailleurs sur la Terre Mère, qui ont créé des relations puissantes, inspirantes et testées par le temps avec les terres et les eaux. Le système capitaliste impérialiste des États-Nations, tel qu’imposé par les forces coloniales occidentales, ne peut mener qu’à la destruction pure et simple des écosystèmes et des populations. Les alternatives à la crise multiple actuelle doivent émerger en dehors des structures en place, en tirant profit des interstices et des brèches du système. On doit faire naître un autre monde afin de rendre les anciennes structures inutiles et les remplacer :
« Nous ne pouvons pas résoudre la crise climatique avec les mêmes infrastructures et concepts axés sur l’industrie qui ont créé la crise. Ces mêmes systèmes et idées qui nous ont mené·e·s à ce point sont incapables de fournir les solutions dont nous avons besoin. Le progrès véritable nécessite que nous faisions la transition vers des approches menées par des Autochtones et une perspective décolonisée, tout en reconnaissant que le savoir et l’intendance Autochtones sont cruciaux pour restaurer l’équilibre et atteindre la vraie justice climatique ». Ces paroles proviennent de Onagoshi-Lila Haymond, paraphrasant sa collègue d’Indigenous Climate Action, Carole Monture.
